Les preuves biochimiques et structurelles montrent que les mutations omicrons sont mieux adaptées à l’ACE2 de souris qu’à l’ACE2 humain
Dans une étude récente publiée dans PNAS, les chercheurs ont montré la base structurelle sur laquelle les mutations omicrons nichées dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) se sont adaptées à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) de souris plutôt qu'à l'ACE2 humaine. Étude : Base structurelle pour la reconnaissance des récepteurs de souris par la variante Omicron du SRAS-CoV-2. Crédit image : Naeblys/Shutterstock Contexte Il y a beaucoup de spéculations sur la source de l’inquiétante variante Omicron (COV) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), mais les preuves expérimentales sont rares. Son apparition soudaine et sa propagation rapide ont soulevé des questions sur son réservoir animal. Quelques résidus d'acides aminés distinguent le RBD prototypique du RBD de...
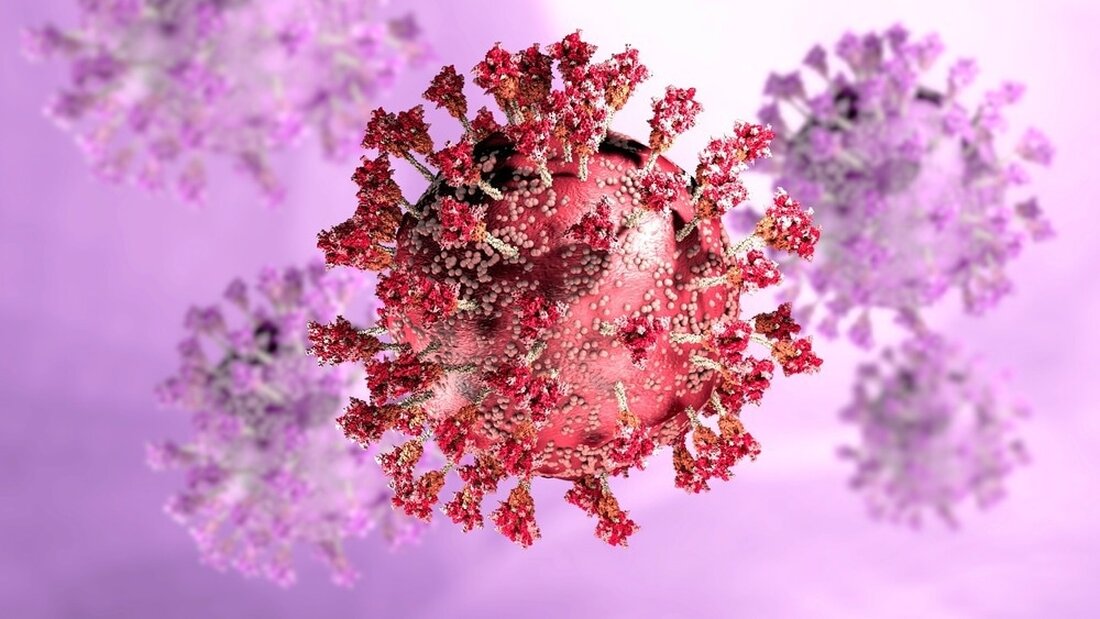
Les preuves biochimiques et structurelles montrent que les mutations omicrons sont mieux adaptées à l’ACE2 de souris qu’à l’ACE2 humain
Dans une étude récente publiée dans PNAS Les chercheurs ont montré la base structurelle sur laquelle les mutations omicrons nichées dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) se sont adaptées à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) de souris plutôt qu'à l'ACE2 humaine.
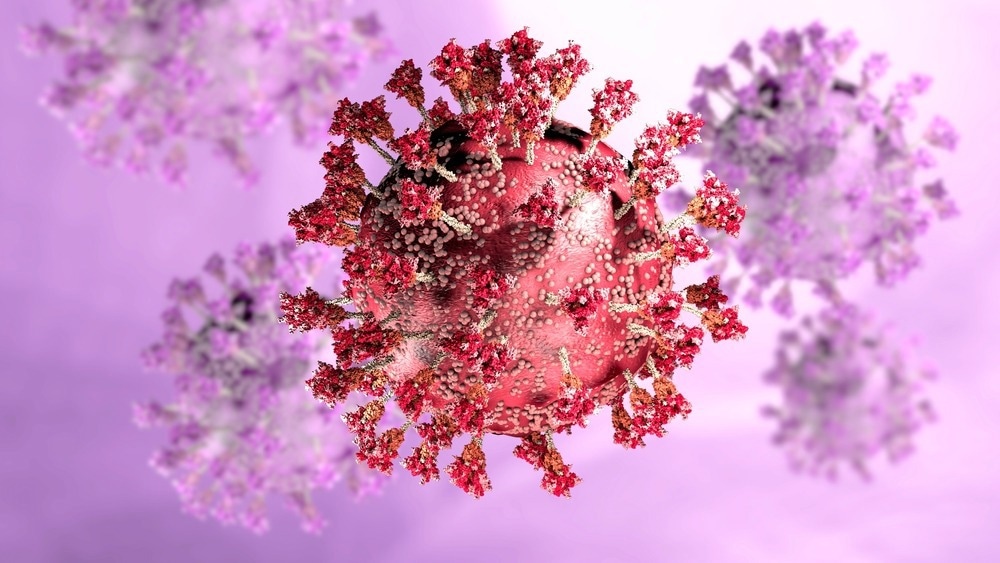
Studie: Strukturelle Grundlage für die Erkennung von Mausrezeptoren durch die Omicron-Variante von SARS-CoV-2. Bildnachweis: Naeblys/Shutterstock
arrière-plan
Il y a beaucoup de spéculations sur la source de l’inquiétante variante Omicron (VOC) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), mais les preuves expérimentales sont rares. Son apparition soudaine et sa propagation rapide ont soulevé des questions sur son réservoir animal.
Quelques résidus d’acides aminés distinguent le RBD prototypique du RBD des coronavirus de chauve-souris. L'Omicron BA.2 RBD diffère du prototype RBD par 16 résidus, dont sept nichés dans le motif de liaison au récepteur (RBM) et en contact direct avec ACE2.
À propos de l'étude
Dans la présente étude, les chercheurs ont récupéré les traces évolutives des mutations omicrons RBM. Ils ont examiné la reconnaissance ACE2 du RBD de l'omicron, en se concentrant sur les mutations Q493R, Q498R, N501Y et Y505H, qui entourent deux points chauds de mutation, le point chaud-31 ou le point chaud-353.
Les chercheurs ont utilisé la mutagenèse dirigée pour synthétiser le gène qui code pour les prototypes S, hACE2 et mACE2 du SARS-CoV-2. Ensuite, ils ont utilisé un test de résonance plasmonique de surface (SPR) pour mesurer les interactions de liaison entre les RBD et les molécules ACE2. Pour confirmer les données SPR, l’équipe a également effectué un test d’entrée du pseudovirus Omicron. Ils ont emballé des pseudovirus Omicron avec quatre mutations inverses (Q493R, Q498R, N501Y et Y505H) avant d'infecter les cellules exprimant mACE2.
Enfin, l’équipe a déterminé la structure cristalline d’Omicron RBD en complexe avec l’ACE2 de souris à 2,84 Å.
Résultats de l'étude
Bien que le prototype SARS-CoV-2 n’ait pas infecté efficacement les souris, d’autres COV SARS-CoV-2 antérieurs provenant d’humains et d’autres espèces animales avaient développé la mutation N501Y pour faciliter l’utilisation du récepteur mACE2 par le SARS-CoV-2. De plus, seules les souris possèdent de l’asparagine (Asn31) et de l’histidine (His353) dans leur séquence ACE2, ce qui suggère qu’Omicron a évolué chez la souris.
L’analyse SPR a montré que le RBD prototypique ne s’est pas lié à mACE2, tandis que l’Omicron RBD s’est lié à mACE2 avec une bonne affinité. L’introduction des mutations inverses R493Q, R498Q, Y501N et H505Y dans le RBD de l’omicron n’a que légèrement réduit la liaison mACE2. De plus, l’étude a identifié des mutations RBM Q493R, Q498R et Y505H qui sont structurellement spécifiquement adaptées à mACE2, ce qui suggère que ces mutations étaient les traces évolutives laissées par Omicron.
C'est probablement ce qui s'est produit au cours de l'évolution du SRAS-CoV-2 : un variant du SRAS-CoV-2 contenant la mutation N501Y s'est propagé des humains ou d'une autre espèce animale aux souris. Plus tard, à mesure que cette variante se propageait chez la souris, des mutations RBM spécifiques à la souris (par exemple Q493R, Q498R et Y505N) se sont développées, contribuant à l'émergence du COV Omicron. Les séquences ACE2 de certaines espèces de rats contiennent également Asn31 ou His353. En plus des humains, Omicron peut avoir été transmis à d’autres espèces dont l’ACE2 contenait des résidus de motifs de liaison virale (VBM) compatibles avec l’Omicron RBD.
Le complexe chimérique Omicron RBD-chimère mACE2 a révélé les interactions étendues entre l’Omicron RBM et les motifs de liaison du virus mACE2 (VBM). Hotspot-31 stabilise le cœur de l’interface RBM/VBM, où les résidus lysine-31 et acide glutamique35-VBM forment une liaison hydrogène avec la glutamine493. Dans mACE2, le résidu 31 est une asparagine et remplace Lys31 dans hACE2. Ainsi, Arg493 dans RBM forme deux liaisons hydrogène bifurquées avec Asn31-VBM à l'interface entre l'Omicron RBM et les VBM de souris, stabilisant ainsi l'interface RBM/VBM et augmentant l'affinité d'Omicron RBD pour mACE2. Dans l’ensemble, la mutation Omicron Q493R entourant le hotspot-31 s’est structurellement adaptée à Asn31 dans mACE2.
Conclusions
Les données de l’étude actuelle ont montré que l’Omicron RBD était bien adapté à l’ACE2 de souris avant même qu’il ne commence à infecter les humains. Les chercheurs ont utilisé des preuves biochimiques et structurelles pour montrer que les souris facilitaient le développement du COV Omicron, fournissant ainsi des informations indispensables sur l’origine évolutive du SRAS-CoV-2. Ces découvertes faciliteraient également la surveillance épidémiologique du SRAS-CoV-2 chez les animaux tels que les souris et les rats pour élucider l’histoire évolutive du SRAS-CoV-2 et prévenir de futures pandémies de coronavirus.
Référence:
- Strukturelle Grundlage für die Erkennung von Mausrezeptoren durch die Omicron-Variante von SARS-CoV-2, Wei Zhang, Ke Shi, Qibin Geng, Gang Ye, Hideki Aihara und Fang Li, PNAS 2022, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2206509119.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
